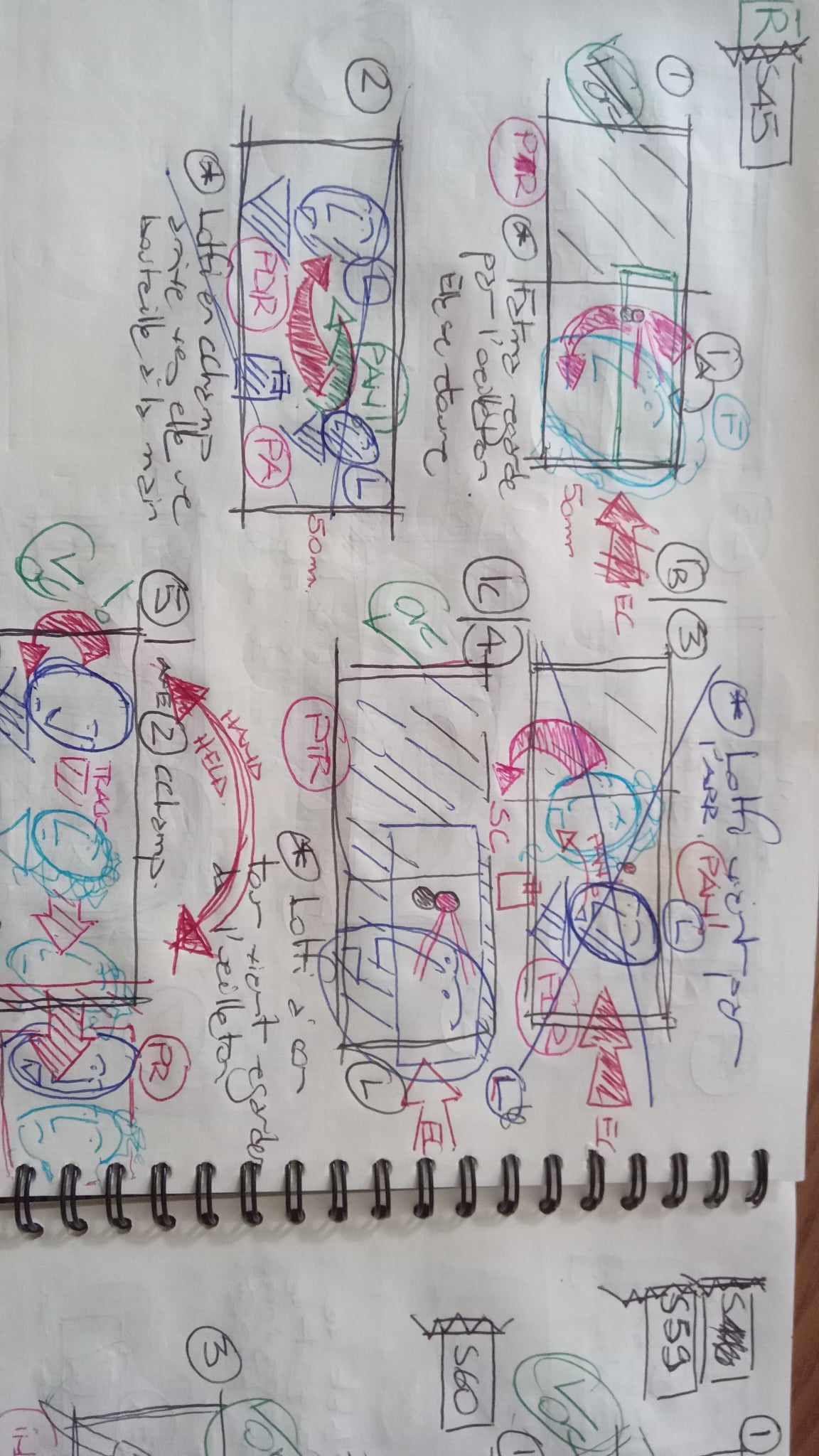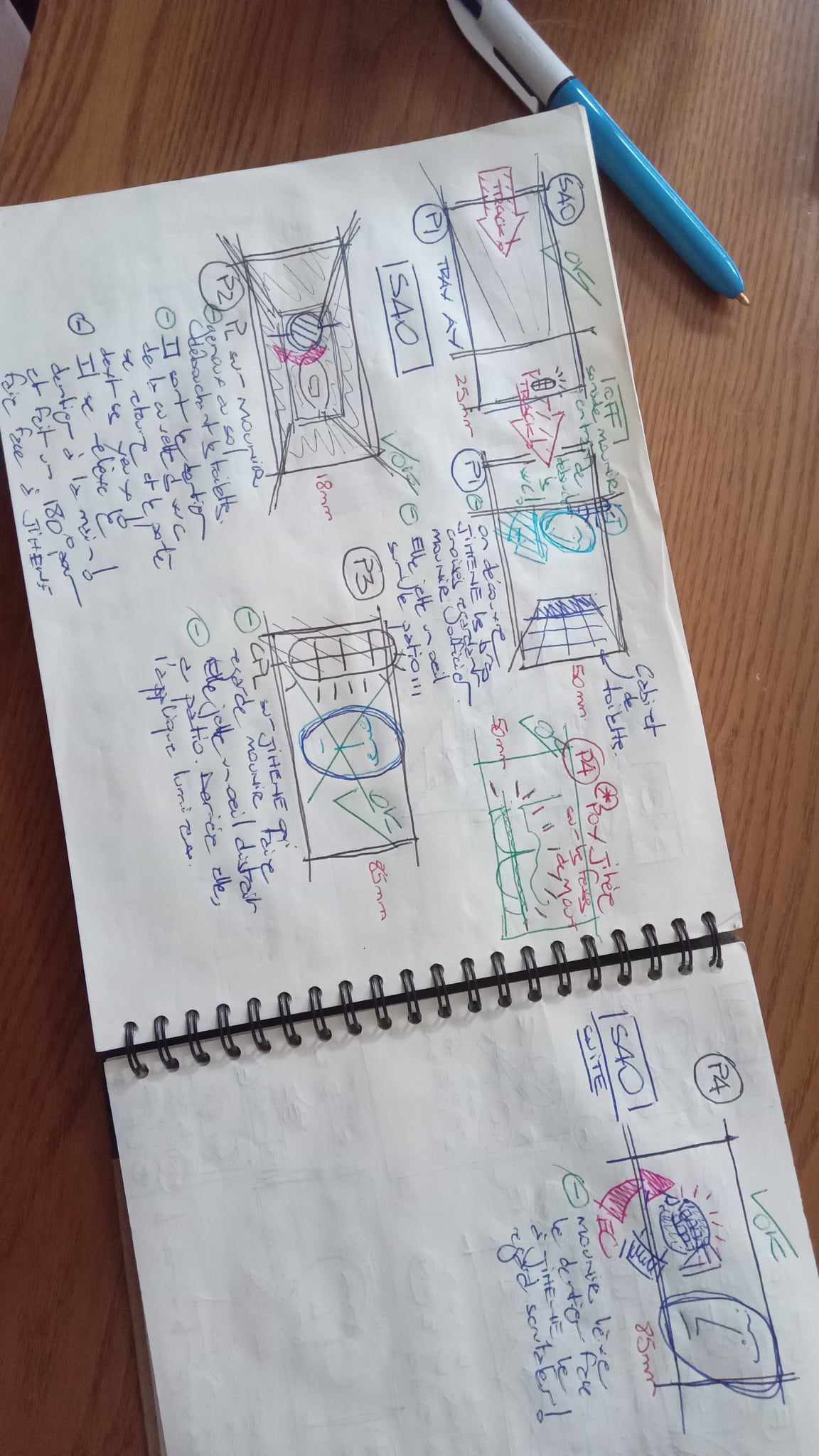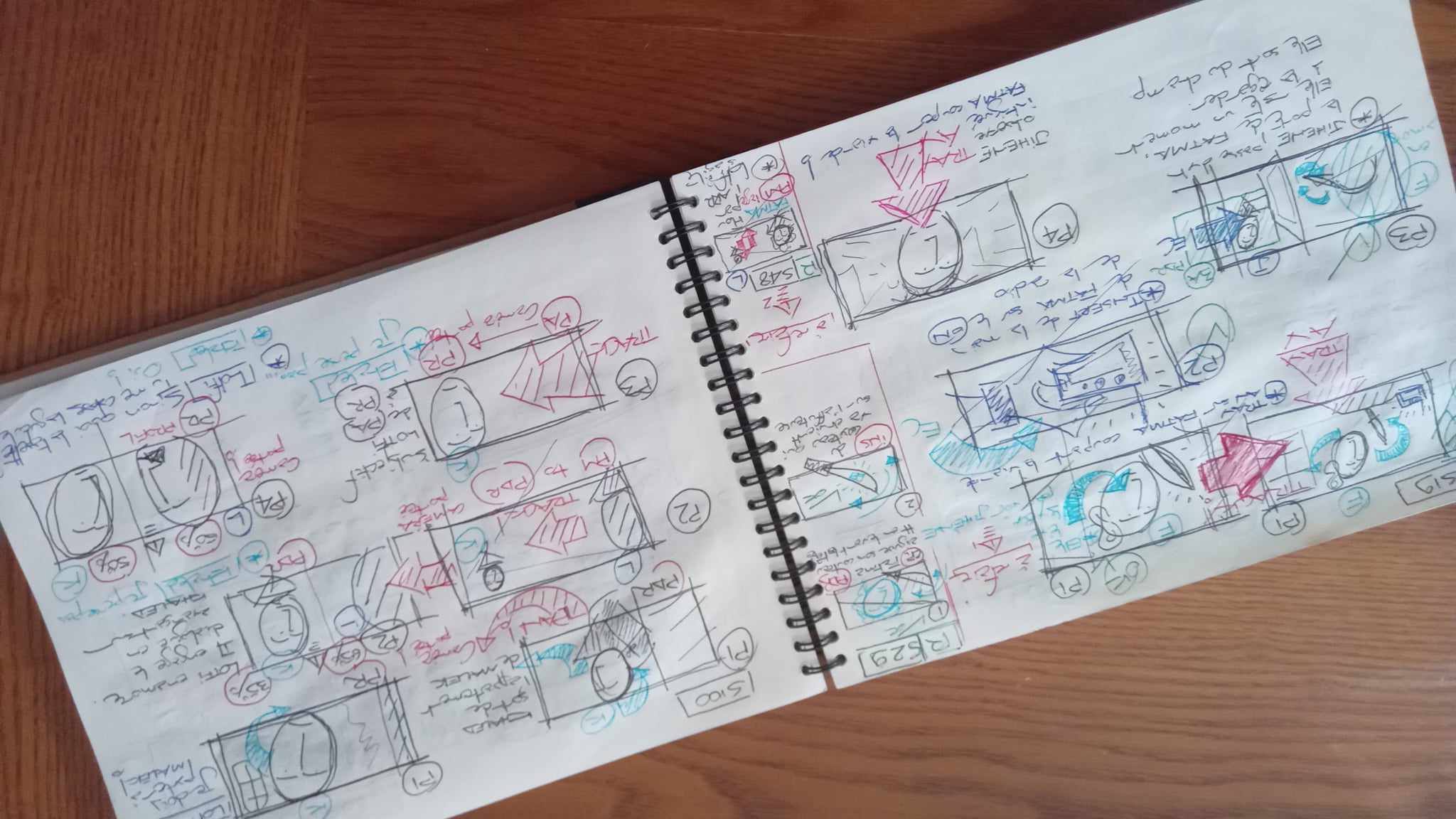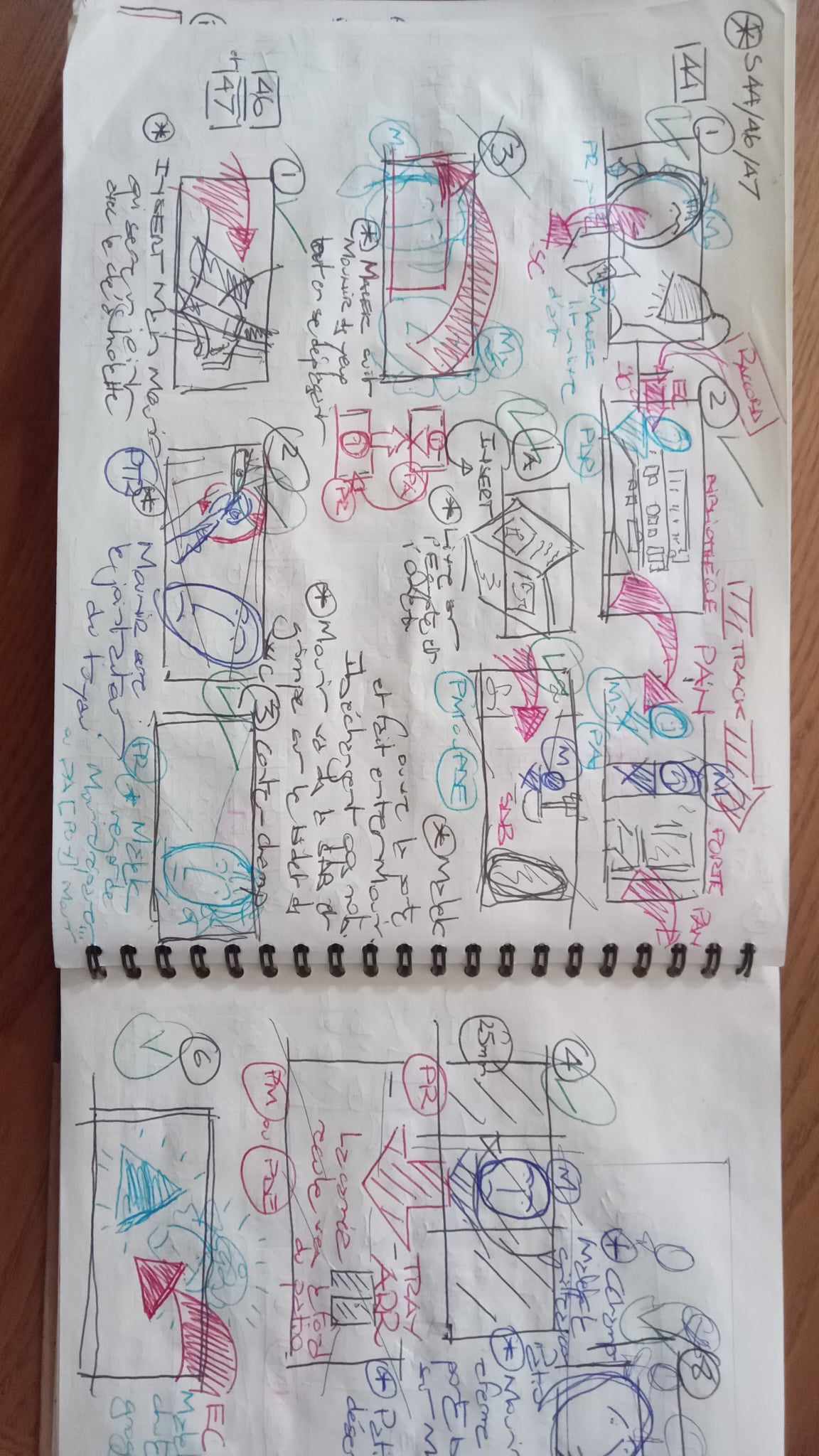Storytelling
Silentium et Moi, Moi et Silentium
Je ne vous dirais rien !
Je ne parlerai pas du contenu du film, de son esthétique, ni de son histoire. Pour ça, il vous faudra le voir. Pour ma part, j’aime dire que j’y ai pris du plaisir. Je l’ai vu à plusieurs reprises. Redécouvert à chaque fois. Parce que le texte est de moi, parce qu’il a été étudié et pensé à deux. Parce qu’il a été réalisé par un cinéaste sensible et talentueux.
Je peux par contre vous parler du texte filmique, de ce que ça m’a fait d’écrire Silentium.
Ecrire est toujours une gageure. Parfois, soyons honnête, un calvaire. D’abord l’angoisse de la page blanche, à chaque saut de page, à chaque respiration, puis il y a les perpétuels questionnements : l’obsession psychotique du « que dire » et « comment le dire », l’implacable «est –ce –que ça a du sens », l’inévitable «non ça ne va pas», l’orgasmique «bordel ! Je crois que c’est bon ». En fait, écrire c’est reconnaitre que l’on peut être à la fois fragile et sensible mais aussi un peu barge, schizo et maso. C’est exactement comme ça que je me suis sentie à l’écriture de Silentium. D’abord parce que c’est une histoire inspirée de faits réels et surtout parce que ce n’est pas facile d’écrire et de décrire le sordide, la noirceur humaine. L’exposer, c’est dérangeant. Ça fait mal !
Du coup, intégrer au texte de la lumière, de l’espoir, de la beauté, c’est vital. Ça peut prendre la forme d’une action, d’une respiration. Ça peut être un contrepoint, un personnage, une figure, une réplique, un mot, un son, un moment de grâce. C’est tout aussi difficile et là aussi ça fait mal ! J’ai mal et pourtant j’anticipe nos échanges avec Nidhal, j’appréhende et m’impatiente des lectures et relectures, je fini par aimer l’idée que je m’en fais, à adopter celle du réal, sa manière de percevoir les personnages, de construire leur univers. Ses regards, ses visions, ses attentes et intentions. Mais j’ai aussi peur ! Peur du film. Peur de Nidhal. Peur de sa magie, de ce qu’il va modeler, peur du monstre à venir. Une peur un peu folle, irraisonnée, panique, jouissive. Psychotique.
Je n’ai pas pu assister au tournage, mais j’y ai pensé tous les jours, toute la durée de la préparation, du tournage, du montage. Durant ces étapes, le contact est assuré tout du long, Avec Nidhal, le texte, n’est jamais fini ou abouti. Il n’est pas inscrit dans le marbre. Les métamorphoses nécessitent du temps, de l’amour, des doutes, des interrogations et des trouvailles. Déconstruire, reconstituer, reconstruire, reformuler, repenser, réinventer.
Quand vient le montage, la énième écriture, s’installe un sentiment terrible. Une déchirure, une abdication, un deuil, C’est une histoire d’espace : le texte m’échappe, il cède définitivement sa place au film. On peut encore écrire, quand le faiseur de magie le souhaite ou que le film l’impose. Mais ce n’est plus seulement du texte ; c’est un son, un plan, un bloc à placer ou déplacer. Une voix, une intériorité à penser et à insuffler. Des ajustements et parfois du sens à réinventer. Le film est une composition collective, une partition qui se joue à plusieurs mains. Et là aussi ça fait mal !
Mais c’est un mal nécessaire, un mal jouissif, orgasmique. Un mal pour un bien. Parce qu’il donne vie. Parce qu’il donne envie. De recommencer. D’écrire à nouveau.
Shuuut… Silence ça rédige !
Sophia Haoues
Crédit photo Nidhal Chatta
Je ne vous dirais rien !
Je ne parlerai pas du contenu du film, de son esthétique, ni de son histoire. Pour ça, il vous faudra le voir. Pour ma part, j’aime dire que j’y ai pris du plaisir. Je l’ai vu à plusieurs reprises. Redécouvert à chaque fois. Parce que le texte est de moi, parce qu’il a été étudié et pensé à deux. Parce qu’il a été réalisé par un cinéaste sensible et talentueux.
Je peux par contre vous parler du texte filmique, de ce que ça m’a fait d’écrire Silentium.
Ecrire est toujours une gageure. Parfois, soyons honnête, un calvaire. D’abord l’angoisse de la page blanche, à chaque saut de page, à chaque respiration, puis il y a les perpétuels questionnements : l’obsession psychotique du « que dire » et « comment le dire », l’implacable «est –ce –que ça a du sens », l’inévitable «non ça ne va pas», l’orgasmique «bordel ! Je crois que c’est bon ». En fait, écrire c’est reconnaitre que l’on peut être à la fois fragile et sensible mais aussi un peu barge, schizo et maso. C’est exactement comme ça que je me suis sentie à l’écriture de Silentium. D’abord parce que c’est une histoire inspirée de faits réels et surtout parce que ce n’est pas facile d’écrire et de décrire le sordide, la noirceur humaine. L’exposer, c’est dérangeant. Ça fait mal !
Du coup, intégrer au texte de la lumière, de l’espoir, de la beauté, c’est vital. Ça peut prendre la forme d’une action, d’une respiration. Ça peut être un contrepoint, un personnage, une figure, une réplique, un mot, un son, un moment de grâce. C’est tout aussi difficile et là aussi ça fait mal ! J’ai mal et pourtant j’anticipe nos échanges avec Nidhal, j’appréhende et m’impatiente des lectures et relectures, je fini par aimer l’idée que je m’en fais, à adopter celle du réal, sa manière de percevoir les personnages, de construire leur univers. Ses regards, ses visions, ses attentes et intentions. Mais j’ai aussi peur ! Peur du film. Peur de Nidhal. Peur de sa magie, de ce qu’il va modeler, peur du monstre à venir. Une peur un peu folle, irraisonnée, panique, jouissive. Psychotique.
Je n’ai pas pu assister au tournage, mais j’y ai pensé tous les jours, toute la durée de la préparation, du tournage, du montage. Durant ces étapes, le contact est assuré tout du long, Avec Nidhal, le texte, n’est jamais fini ou abouti. Il n’est pas inscrit dans le marbre. Les métamorphoses nécessitent du temps, de l’amour, des doutes, des interrogations et des trouvailles. Déconstruire, reconstituer, reconstruire, reformuler, repenser, réinventer.
Quand vient le montage, la énième écriture, s’installe un sentiment terrible. Une déchirure, une abdication, un deuil, C’est une histoire d’espace : le texte m’échappe, il cède définitivement sa place au film. On peut encore écrire, quand le faiseur de magie le souhaite ou que le film l’impose. Mais ce n’est plus seulement du texte ; c’est un son, un plan, un bloc à placer ou déplacer. Une voix, une intériorité à penser et à insuffler. Des ajustements et parfois du sens à réinventer. Le film est une composition collective, une partition qui se joue à plusieurs mains. Et là aussi ça fait mal !
Mais c’est un mal nécessaire, un mal jouissif, orgasmique. Un mal pour un bien. Parce qu’il donne vie. Parce qu’il donne envie. De recommencer. D’écrire à nouveau.
Shuuut… Silence ça rédige !
Sophia Haoues
Crédit photo Nidhal Chatta